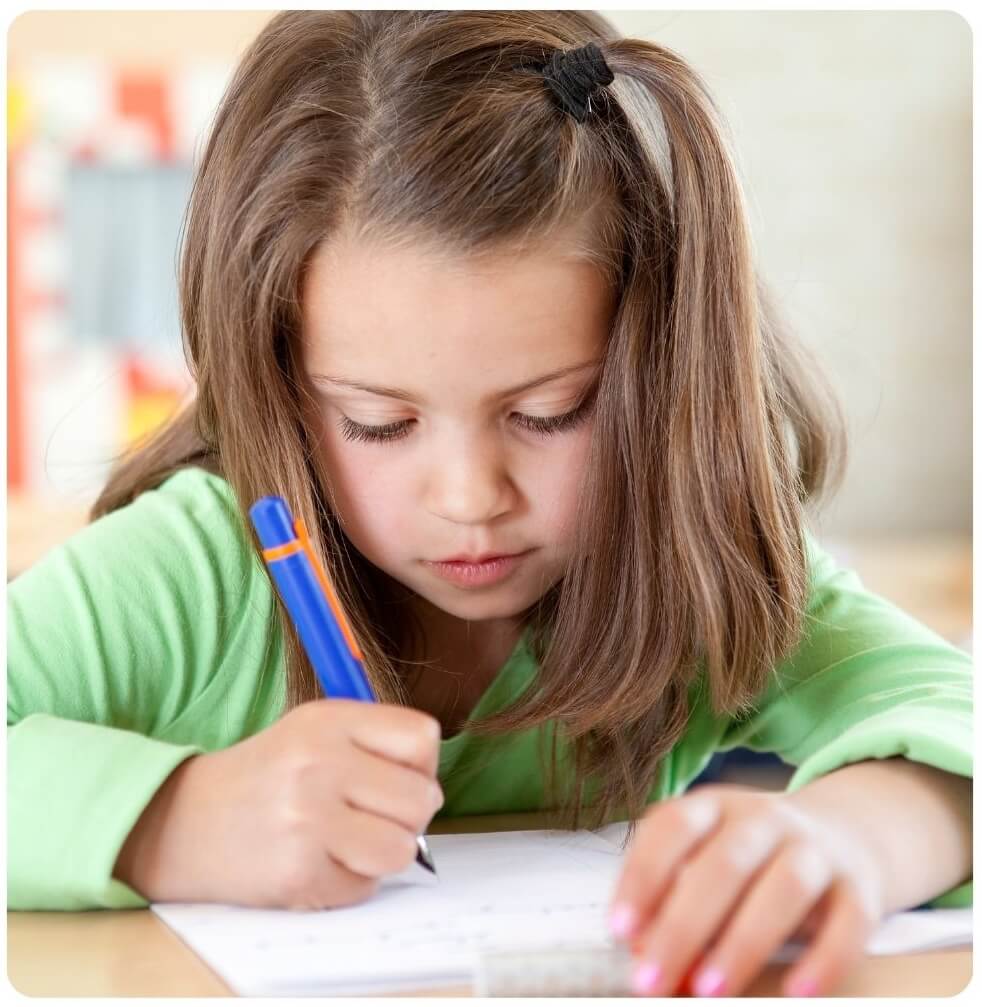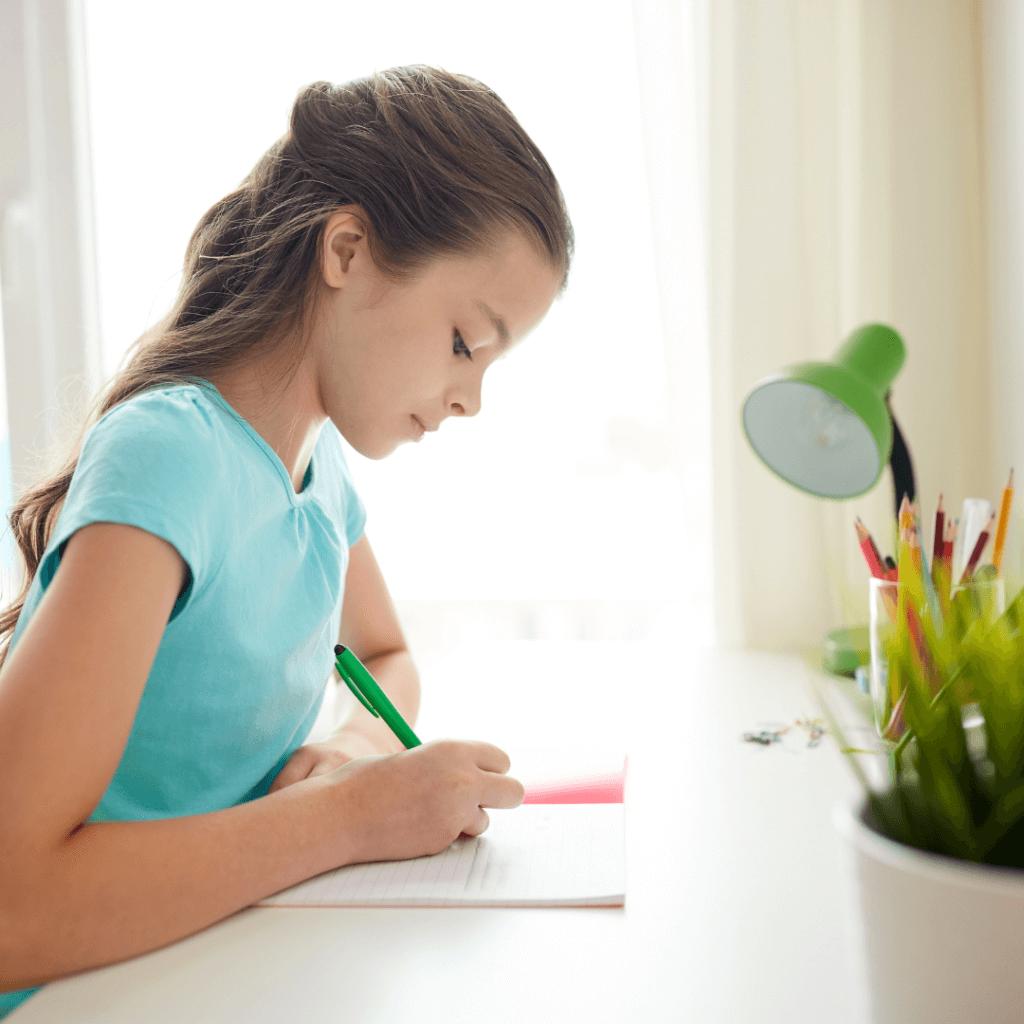Développer la métacognition à l’école.
Et si la réussite scolaire ne dépendait pas seulement de ce que l’on apprend, mais surtout de notre manière d’apprendre ?
Développer la métacognition à l’école permet d’aider chaque élève à mieux comprendre, apprendre et réussir.
La métacognition, souvent négligée, constitue un levier pédagogique puissant pour transformer les pratiques éducatives et favoriser la réussite de tous les élèves !
Qu’est-ce que la métacognition ?

La métacognition désigne la capacité d’un individu à prendre conscience de ses processus mentaux et à les réguler de manière intentionnelle.
En premier lieu, elle implique de pouvoir réfléchir à :
- sa façon d’apprendre,
- d’évaluer ses performances
- et d’ajuster ses stratégies en conséquence.
Elle englobe :
👉 la régulation de l’attention,
👉 la planification,
👉 la résolution de problèmes,
👉 la détection et la correction des erreurs.
Donc cette compétence cognitive se construit tout au long de la vie, mais elle peut et doit être développée activement dès le plus jeune âge.
Dans le cadre scolaire, un élève métacognitif identifie les tâches à accomplir et planifie ses actions.
Il surveille sa compréhension, détecte ses erreurs et modifie ses approches si nécessaire.
Loin d’être innée, cette capacité se nourrit d’un environnement scolaire bienveillant, structuré et riche en retours formatifs, les fameux « feed-back ».
Important : Les recherches menées par le Conseil scientifique de l’Éducation nationale insistent sur l’importance de guider explicitement les élèves, notamment ceux issus de milieux défavorisés qui ne développent pas spontanément ces compétences s’ils ne sont pas accompagnés.
Ainsi, l’enseignant devient un médiateur du raisonnement et de l’auto-évaluation.
Il explicite les démarches, encourage la verbalisation des choix stratégiques et valorise la réflexion sur les erreurs.
En cela, la métacognition n’est pas un objectif pédagogique parmi d’autres !
👍 En effet, elle est un fondement transversal de tout apprentissage durable.
Autorégulation et métacognition à l’école : 3 conditions clés
L’apprentissage autorégulé consiste pour l’apprenant à :
- se fixer un objectif,
- choisir des stratégies pour l’atteindre,
- surveiller ses actions,
- évaluer ses progrès
- et vérifier ses résultats.
Cela implique un contrôle de son activité cognitive (planification, mise en œuvre) et une évaluation de celle-ci (conscience de ses connaissances, difficulté perçue, effort fourni, compréhension ressentie).

Précisons que l’autorégulation de l’apprentissage repose sur 3 conditions essentielles :
- Premièrement, pouvoir apprendre: pour s’autoréguler, l’élève doit d’abord disposer des compétences nécessaires pour comprendre et réaliser une tâche.
Cela implique que l’activité proposée soit dans sa zone proximale de développement (ZPD).
L’enseignant doit donc connaître les acquis de ses élèves et adapter les tâches à leurs niveaux.
Des médiations spécifiques sont parfois nécessaires (supports visuels, consignes simplifiées, etc.) pour respecter la diversité cognitive des élèves.
- Deuxièmement, vouloir apprendre: La motivation est essentielle pour que l’élève s’engage dans l’apprentissage, même si celui-ci est à sa portée.
Les motivations peuvent être intrinsèques (plaisir d’apprendre, curiosité) ou extrinsèques (notes, récompenses).
Les activités les plus efficaces sont celles qui suscitent une motivation intrinsèque.
Elles doivent être ajusté à la bonne difficulté et bien structurées, pour renforcer l’engagement et la confiance en soi.
- Troisièmement, pouvoir s’évaluer: L’auto-évaluation, essentielle à la régulation cognitive, comprend 2 aspects :
- Prévoir ses capacités et l’effort à fournir pour l’apprentissage.
- Évaluer les résultats après coup.
Cette auto-évaluation repose sur des sentiments de certitudes ou d’incertitude relatifs au succès.
Il repose également sur des croyances personnelles sur les tâches scolaires et les compétences scolaires.
C’est bien que l’on appelle les sentiments métacognitifs.
Un frein à développer la métacognition à l’école
❌ Les croyances limitantes !
Pour aider tous les élèves à apprendre à apprendre, il est essentiel de développer la métacognition à l’école !
Il est aussi essentiel de comprendre que les croyances de l’élève sur lui-même et sur l’école influencent fortement son autorégulation.
Par exemple, un élève peut penser qu’il n’est « pas fait pour les maths », ou que « l’école, ce n’est pas pour lui ».
👉 Ces croyances, souvent issues de l’environnement familial et social, constituent des biais métacognitifs qui freinent l’apprentissage.

➡️ Les biais socio-cognitifs
Les stéréotypes liés au genre, à l’origine sociale ou à l’appartenance ethnique renforcent ces biais.
Par exemple, certaines filles se pensent « moins bonnes » en mathématiques.
Ou encore des élèves issus de milieux populaires estiment que certaines matières « ne sont pas pour eux ».
Ces croyances, même inconscientes, orientent les efforts et les attentes.
Elles peuvent détourner les élèves des apprentissages, les poussant à chercher une reconnaissance ailleurs:
- popularité,
- sport,
- réseaux sociaux…
➡️ L’effet du contexte
Les recherches montrent que le contexte active des représentations de soi différentes :
✅ à l’école, chez soi, entre amis, l’élève adopte des identités variables.
Ces identités influencent sa manière de s’impliquer dans une tâche.
L’enseignant peut donc agir sur le contexte, en créant un environnement où les élèves se sentent capables, légitimes et reconnus dans leurs efforts.
Il doit éviter de renforcer les images négatives de soi. Il doit également favoriser des représentations identitaires positives, compatibles avec l’apprentissage.
Développer la métacognition à l’école : Quelle tratégie ?

✅ Poursuivons par la place primordiale de l’enseignant !
En effet, il joue un rôle-clé pour faire émerger, accompagner et renforcer la métacognition chez ses élèves :
1 – Rendre explicite l’objectif d’apprentissage
2 – Encourager l’auto-réflexion
3 – Accompagner l’échec et valoriser l’erreur.
1 – Premièrement, rendre explicite l’objectif d’apprentissage
L’enseignant ne se contente pas de donner une consigne.
Il explique :
- pourquoi l’activité est proposée,
- quel est le but d’apprentissage,
- comment la tâche y conduit.
Cela permet aux élèves de donner du sens à leur travail, d’orienter leur attention et de devenir acteurs de leur apprentissage.
2 – Ensuite, encourager l’auto-réflexion
L’enseignant invite les élèves à se questionner sur leurs démarches.
Il les aide à verbaliser leurs stratégies et à identifier ce qui a bien ou mal fonctionné.
Il les incite à anticiper les difficultés, à ajuster leurs efforts, et à envisager d’autres façons de faire.
3 – Enfin, accompagner l’échec et valoriser l’erreur.
L’enseignant présente l’erreur non comme un échec, mais comme un indicateur précieux pour progresser.
Il enseigne à ses élèves que l’on apprend en faisant, en se trompant et en corrigeant.
Il valorise la résilience cognitive, c’est-à-dire la capacité à persister malgré les difficultés.
En conclusion, développer la métacognition à l’école est un levier puissant pour la réussite de tous !
La métacognition transforme la manière dont les élèves apprennent.
En comprenant leurs processus mentaux, en les régulant activement, ils deviennent plus autonomes, motivés et confiants.
Mais cette compétence ne va pas de soi !
Elle s’enseigne, se cultive et se soutient.
L’enseignant, par sa posture et ses choix pédagogiques, joue un rôle déterminant dans la réussite de ses élèves.
👉 La métacognition vous intéresse 💬
Vous appliquez déjà des stratégies métacognitives en classe ?
Partagez vos retours en commentaire !
📩 Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre newsletter pédagogique !